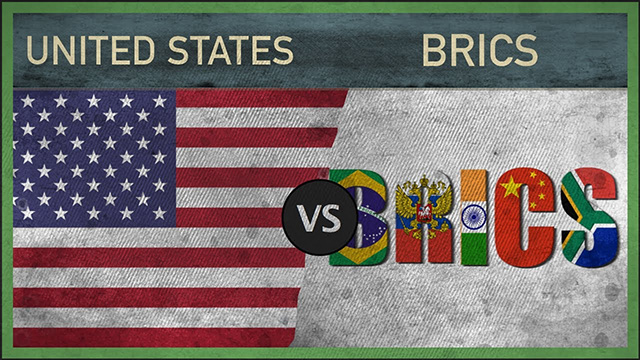La décision des États-Unis de boycotter la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Johannesburg a des implications diplomatiques et géopolitiques importantes. Cette décision met en évidence les tensions croissantes entre Washington et Pretoria, alimentées par des différences sur la gouvernance mondiale, les institutions juridiques internationales et la géopolitique du Moyen-Orient. La Cour pénale internationale (CPI) et la Cour internationale de justice (CIJ) ont toutes deux intenté une action en justice contre Israël, un allié clé des États-Unis. Il est devenu un critique majeur de la politique étrangère américaine en raison de l’opposition de l’Afrique du Sud aux politiques d’Israël, ce qui a entraîné des tensions accrues au sein de forums mondiaux tels que le G20.
Sous l’actuel président Donald Trump, les États-Unis ont adopté une politique étrangère « America First », qui donne la priorité à la souveraineté nationale plutôt qu’à la coopération mondiale. Cette approche est enracinée dans la conviction que les institutions internationales, y compris celles qui régissent le commerce, la sécurité et les droits de l’homme, fonctionnent souvent au détriment des intérêts américains. Selon Trump, des organisations comme l’Organisation mondiale du commerce (OMT), les Nations Unies (ONU) et en particulier la Cour pénale internationale ciblent les États-Unis et leurs alliés de manière disproportionnée tout en omettant de résoudre des problèmes mondiaux plus larges.
L’une des principales sources de friction entre Washington et Pretoria a été les enquêtes de la CPI sur des crimes de guerre présumés commis par les États-Unis et leurs alliés, y compris Israël.L’administration Trump a précédemment imposé des sanctions aux responsables de la CPI lorsque le tribunal a tenté d’enquêter sur les actions militaires américaines en Afghanistan. Ces sanctions ont été levées sous le président Joe Biden, qui a exprimé son soutien aux poursuites de la CPI liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cependant, la situation a changé lorsque la CPI a émis un mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, l’accusant de commettre des crimes de guerre à Gaza.
L’Afrique du Sud a joué un rôle de premier plan dans l’ouverture de cette affaire contre Israël, ce qui a encore accru les tensions avec Washington. Les États-Unis Le Congrès a réagi fortement, considérant les actions de la CPI comme une attaque contre son plus proche allié du Moyen-Orient. En représailles, plusieurs législateurs américains ont fait pression pour de nouvelles sanctions contre la CPI, arguant que le tribunal se livrait à des poursuites à motivation politique.
Le défi juridique de l’Afrique du Sud contre Israël et les États-Unis. Contrecoup
Au-delà des actions de la CPI, l’Afrique du Sud a également intenté une action en justice contre Israël à la CPI, l’accusant de commettre un génocide à Gaza. La CIJ, le principal organe judiciaire de l’ONU, a accepté d’entendre l’affaire, ce qui a encore tendu les relations entre Pretoria et Washington. Cette décision a positionné l’Afrique du Sud comme l’un des critiques les plus virulents des politiques israéliennes sur la scène mondiale, s’alignant sur les nations du Sud et les mouvements pro-palestiniens.
Le 31 janvier 2024, l’Afrique du Sud et la Malaisie ont lancé conjointement une campagne diplomatique pour faire respecter les décisions de la CPI et de la CPI, appelant d’autres pays à reconnaître et à faire respecter ces décisions juridiques. Les États-Unis, en revanche, ont tenté de saper ces décisions, ce qui a conduit à une impasse diplomatique entre Washington et Pretoria. La divergence croissante dans leurs priorités en matière de politique étrangère a créé un fossé entre les États-Unis et l’Afrique du Sud, avec des implications plus larges pour la diplomatie internationale.
En réponse aux tensions actuelles, les États-Unis Le secrétaire d’État Marco Rubio a annoncé via Twitter qu’il n’assisterait pas à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Johannesburg. Cette décision marque un boycott diplomatique important de la part des États-Unis, signalant leur mécontentement à l’égard de la position de l’Afrique du Sud sur Israël et la CPI.
Cette décision s’aligne sur des modèles plus larges de la politique étrangère américaine, en particulier sous Trump, qui a souvent cherché à remettre en question la pertinence des institutions multilatérales lorsqu’elles entrent en conflit avec les intérêts stratégiques américains. Au cours de son premier mandat (2017-2021), Trump a poussé à remodeler les discussions du G20, en préconisant le « commerce réciproque » au lieu du libre-échange et en s’opposant aux accords climatiques mondiaux. Il semble que son approche du G20 et d’autres organisations internationales pourrait devenir encore plus radicale et isolationniste.
Conséquences économiques et diplomatiques pour les relations entre les États-Unis et l’Afrique du Sud
Le boycott américain de la réunion du G20 n’est pas seulement symbolique – il a des conséquences économiques et diplomatiques tangibles. Trump et ses alliés ont été de plus en plus critiques à l’égard des politiques intérieures de l’Afrique du Sud, en particulier en ce qui concerne la réforme agraire et les questions raciales. Trump a précédemment accusé l’Afrique du Sud de s’engager dans la « dépisation des terres » contre les agriculteurs blancs, faisant écho aux récits promus par les groupes de droite. Ces accusations ont également été amplifiées par des personnalités telles qu’Elon Musk, un milliardaire d’origine sud-africaine, qui a publiquement critiqué les politiques de Pretoria.
En outre, les États-Unis ont commencé à réduire l’aide financière à l’Afrique du Sud, invoquantdes préoccupations concernant la gouvernance et les désaccords en matière de politique étrangère. Cette décision est susceptible d’affaiblir davantage les relations entre les États-Unis et l’Afrique du Sud, rapprochant Pretoria de la Chine, de la Russie et d’autres pays BRICS. L’alignement croissant de l’Afrique du Sud avec les structures alternatives de gouvernance mondiale reflète un changement plus important dans la dynamique du pouvoir mondial, où les nations du Sud de la planète cherchent à contrebalancer l’influence occidentale.
Le G20 est une plate-forme essentielle pour la coopération économique mondiale, réunissant les plus grandes économies du monde pour discuter de défis internationaux urgents. La décision américaine de boycotter la réunion des ministres des Affaires étrangères soulève de sérieuses inquiétudes quant à la cohésion future du G20. Historiquement, le groupe a joué un rôle essentiel dans la stabilisation des marchés financiers mondiaux, la coordination de la politique économique et la gestion des crises géopolitiques. Cependant, lorsqu’un membre majeur comme les États-Unis se retire de ses procédures, cela sape la légitimité et l’efficacité de l’institution.