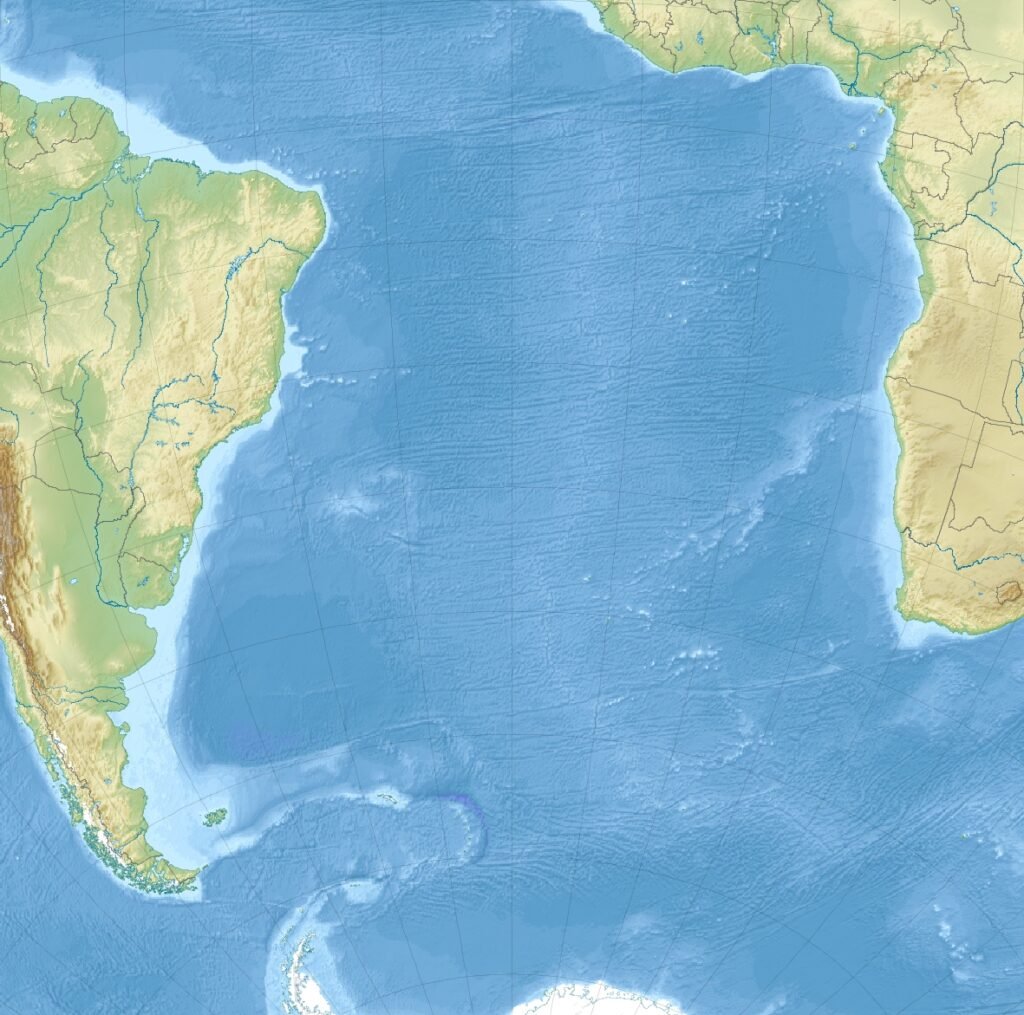Le Sud Atlantique n’est plus un espace de flux illégaux et d’histoires contrariées : il devient un corridor stratégique où s’agrègent nouvelles routes commerciales, coalitions politiques et instruments financiers alternatifs. Sous la pression d’un ordre libéral chancelant, Afrique, Amérique latine et Caraïbes recomposent leurs alliances, diversifient leurs partenaires et revendiquent un droit assumé au multi-alignement. Cette réorganisation silencieuse, documentée par la chercheuse Len Ishmael, dessine un monde où la puissance se joue moins dans les cénacles occidentaux que dans l’architecture patiente de liens « pro-Sud ».
Longtemps, l’Atlantique Sud a cumulé handicaps structurels : héritage colonial, liaisons aériennes et maritimes orientées vers le Nord, faiblesse des mécanismes interrégionaux. Résultat : échanges interrégionaux modestes, qu’il s’agisse de l’Afrique, de la Caraïbe ou de l’Amérique latine, avec des taux d’échanges intra-zones oscillant autour de 12 %–15 %, très éloignés des standards européens ou asiatiques. Cette « géographie contrariée » a également nourri une dépendance logistique coûteuse et un sous-investissement chronique des passerelles Sud-Sud.
La décennie 2020 a toutefois inversé la perspective. L’accumulation de chocs – pandémie, guerres, durcissements tarifaires, crispations technologiques – a poussé les États du Sud à reconfigurer en urgence leurs chaînes d’approvisionnement, à politiser leur commerce et à s’émanciper des « routines » de Bretton Woods. L’heure n’est plus à « choisir un camp », mais à composer : coalitions à la carte, redondance des partenaires, arbitrages de puissance.
Le nouveau logiciel diplomatique du Sud Atlantique tient en trois verbes : diversifier, désintermédier, institutionnaliser. Diversifier, en élargissant le spectre des partenaires – Chine, Inde, Türkiye, États du Golfe – et en modulant l’intensité des liens avec États-Unis et Union européenne. Désintermédier, en contournant des dépendances jugées asymétriques : systèmes de paiement hors-SWIFT, règlements en monnaies locales, garanties multilatérales « Sud-Sud » pour l’accès aux marchés. Institutionnaliser enfin, en densifiant les enceintes non occidentales – BRICS+, G77+Chine, OCS – et en les outillant d’instruments concrets (NDB, mécanisme de garantie BRICS annoncé en 2025, chantiers autour d’une gouvernance de l’IA).
Ce basculement n’est ni « anti-Ouest » ni strictement idéologique. Il est transactionnel : maximiser les options, minimiser les risques. Les annonces tarifaires américaines récentes – y compris des surtaxes de 50 % et la menace d’un prélèvement de 100 % ciblant les membres BRICS et +10 % pour leurs « alignés » – ont agi comme accélérateur de substitution : poussées de commerce intra-Sud, plans de compensation vers la Chine, consolidation de coalitions thématiques. Le cas du Brésil, dont 30 % des exportations partent vers la Chine contre environ 12 % vers les États-Unis, illustre cette marge de manœuvre retrouvée.
La puissance se mesure désormais à la topographie des liaisons. Côté Pacifique, l’inauguration du mégaport de Chancay (Pérou) et le corridor ferroviaire transcontinental Brésil-Bolivie-Pérou (plus de 5 000 km) reconfigurent l’interface Amériques–Asie en réduisant de plusieurs semaines les temps de transit. Côté Atlantique, le projet atlantique marocain ouvre une perspective complémentaire : port en eaux profondes à Dakhla, continuité logistique pour les pays sahéliens enclavés, passerelle énergétique et minérale vers les Amériques, commerce d’engrais vers le Cône Sud. Les flux Maroc-Brésil et Maroc-Argentine s’étoffent, validant l’hypothèse d’un arc atlantique afro-latino.
La révolution est également numérique. Huawei déploie de l’infrastructure 5G au Brésil ; BYD investit la filière VE et batteries entre le Nordeste brésilien et, potentiellement, la côte pacifique andine ; les paiements s’afranchissent des goulots traditionnels avec PAPSS en Afrique et CPASS en Caraïbe. Là encore, la logique est de réduire les coûts de transaction et de sécuriser des rails de paiement résilients face aux turbulences politiques.
Financer sans dépendre : l’ingénierie « pro-Sud »
La finance suit : Afreximbank accorde une ligne de crédit de 3 milliards de dollars à douze États caribéens et projette neuf centres d’affaires transatlantiques. La NDB des BRICS élargit sa boîte à outils, tandis que le mécanisme de garanties multilatérales annoncé vise à « dé-risquer » l’accès des économies plus pauvres aux marchés de capitaux. En Caraïbe, des banques régionales s’implantent en Afrique, et un établissement nigérian prépare la réciproque : la finance devient le ciment discret du corridor. Par capillarité, le Sud capte mieux l’épargne, discipline ses primes de risque et se prémunit contre les chocs de liquidité.
Le mouvement est complété par des fonds et crédits thématiques (énergies renouvelables, sécurité alimentaire), souvent co-portés par le CCG : Emirats, Arabie saoudite et Qatar multiplient acquisitions industrielles, co-investissements miniers (lithium argentin) et projets d’énergie propre au Brésil, tout en nouant des cadres de dialogue structurés avec la Caraïbe (MOU GCC-ACS, fonds renouvelables, sommets dédiés). La géo-économie du Golfe s’invite ainsi dans la fabrique atlantique.
Au-delà des méga-projets, des signaux faibles s’additionnent : missions diplomatiques africaines et caribéennes ouvertes ou renforcées, bourses universitaires (Maroc, Brésil, Mexique), accords « Open Skies » à l’étude entre Afrique et Caraïbe, coopérations sanitaires (achats groupés de vaccins AU-CARICOM pendant la pandémie), programmes indiens de micro-projets communautaires, ou encore coopération technique turque (TIKA) en Méso-Amérique. Ces briques, parfois modestes, institutionnalisent des habitudes de travail et ancrent des interdépendances utiles, loin des dépendances de jadis.
L’effet Chine : leadership d’opportunité plutôt que hégémonie
Pékin joue la montre longue. De TAZARA dans les années 1970 au BRI contemporain (plus de 1 300 milliards de dollars), la Chine occupe l’intervalle laissé par un Occident divisé : financement d’infrastructures, montée en gamme industrielle (EV, composants), diplomatie de l’IA (idée d’un régulateur global) et activisme discret dans les enceintes onusiennes. Son offre est lisible : stabilité, construction, débouchés. Elle séduit d’autant plus que le Sud Atlantique y voit le moyen d’arracher de meilleures conditions dans ses arbitrages avec Washington et Bruxelles. Le risque existe de créer de nouvelles dépendances ; la réponse du « pro-Sud » consiste à mettre en concurrence les appétits, pas à s’aligner sans conditions.
Points durs : le voisin américain, éternel facteur de risque
La proximité des États-Unis demeure ambivalente. Dans la Caraïbe, sanctions, avis de voyage et contentieux migratoires affectent directement le premier secteur d’exportation : le tourisme. En Amérique latine, les surtaxes projetées, les pressions politico-judiciaires et les signaux erratiques sur le climat et le commerce entament la prévisibilité macroéconomique. En Afrique de l’Ouest, la sélection de partenaires « miniers » par la Maison-Blanche fragmente davantage un espace déjà soumis aux recompositions sécuritaires. Autant de raisons pour lesquelles la région double ses assurances collectives : intégrations caribéennes (OECS, CARICOM), AfCFTA, rapprochements bilatéraux Mexique-Brésil, ou encore innovations de dette portées par de petites économies (Initiative de Bridgetown, échanges dette-climat).
Le Sud Atlantique ne se contente plus d’« exister » ; il dessine. Entre ports profonds, rails andins, hubs financiers et normes naissantes, une carte alternative de la mondialisation prend forme, moins verticale, plus polycentrique. La dynamique n’exclut pas l’Occident ; elle le relativise. Le véritable clivage n’oppose pas « pro-Ouest » et « anti-Ouest », mais « pro-statu quo » et « pro-capacité d’agir ». C’est là que se joue la crédibilité du Sud Atlantique : dans sa faculté à convertir l’empilement d’initiatives en gouvernance stable, prévisible et inclusive. Le monde ne reviendra pas à l’ordre ancien ; il attend ceux qui sauront, de part et d’autre de l’Atlantique Sud, penser et financer leurs routes.